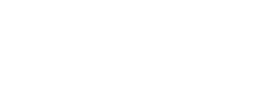Le cinématographe, instrument de chercheurs
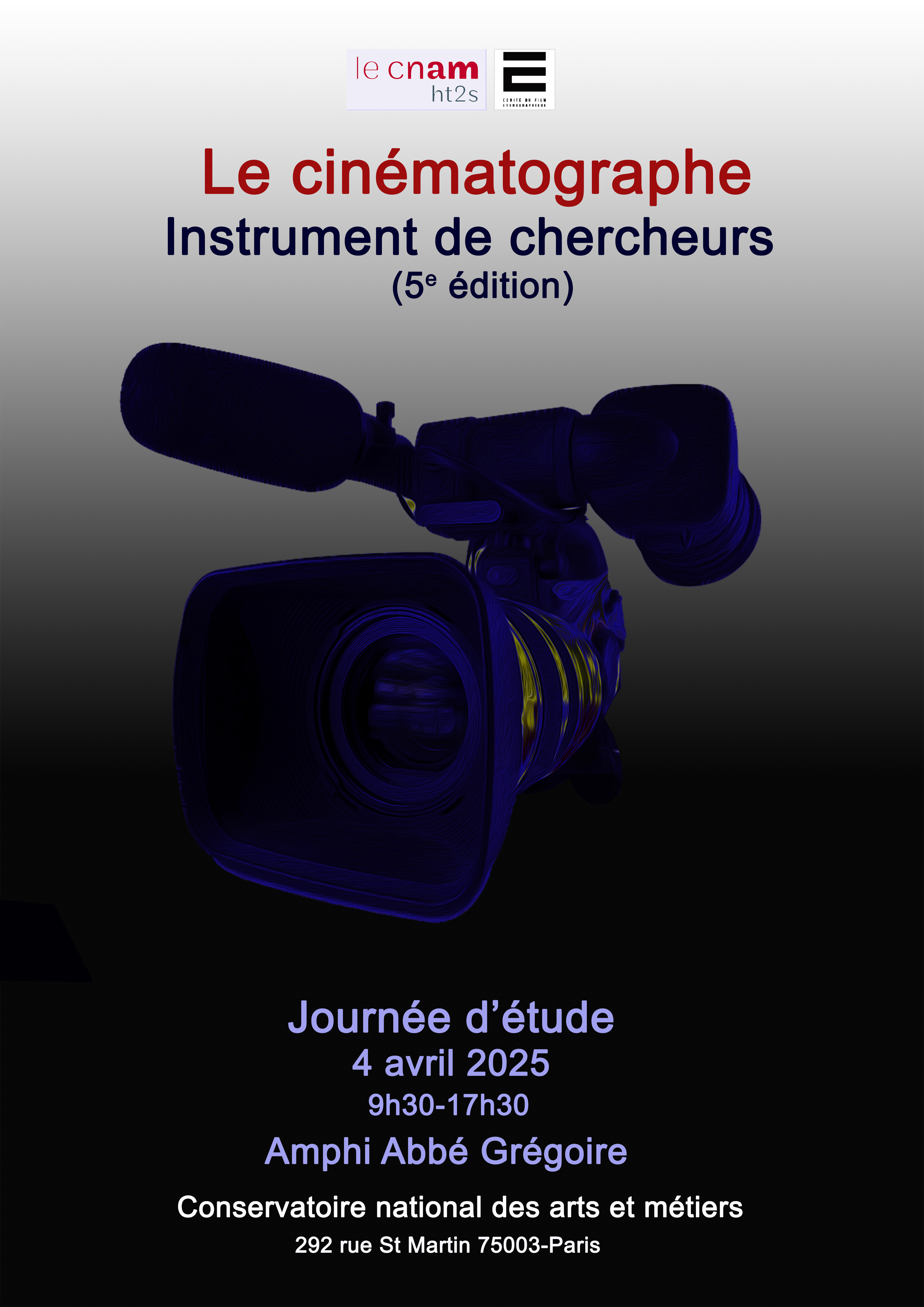
4 avril 20259h30 - 17h30
- Ile-de-France
Amphithéâtre Abbé Grégoire
292 rue St Martin
75003 Paris
images/sons, écriture textuelle/écriture filmique
*
Programme
9h : accueil des participants
9h30 : mots d’accueil
Loïc Petitgirard, Professeur en histoire des sciences et des techniques, directeur du laboratoire HT2S et Nathalie Luca, Directrice de recherche au CNRS et présidente du Comité du film ethnographique
9h40 : Introduction. Le cinématographe, instrument de chercheurs, images/sons, écriture textuelle/écriture filmique
Robert Nardone, Historien, HT2S
Depuis 2018, le laboratoire HT2S organise, chaque année, une journée d’étude sur la place de l’instrument cinématographique dans la recherche scientifique contemporaine. Ces journées débattent des questions -heuristiques, épistémiques, éthiques- que posent l’usage de cet instrument dès lors qu’il participe directement à la formation d’éléments de connaissance. Cette cinquième édition, circonscrite à la pratique cinématographique dans les sciences humaines, invite chercheuses et chercheurs à discuter : i) sur le rapport images/sons (parole comprise) et ii) sur l’articulation écriture filmique/écriture textuelle dans un protocole de recherche.
10h : Vivre avec les dieux. Sur le terrain de l'anthropologie visuelle.
Jean-Paul Colleyn, Directeur d'études EHESS
À partir de mon expérience telle qu’elle est relatée dans notre œuvre collective (Augé et al, 2018) et nourrie des réflexions ultérieures, j’aborderai les choix de préparation, de tournage, de montage et de mixage qui régissent le rapport images /textes et images/sons que nous avons effectués au sein de cette équipe d’anthropologie visuelle qui a produit cinq documentaires en une dizaine d’années. Quel que soit le degré de préparation, de nombreux choix s’effectuent sur le champ en fonction de contraintes liées soit aux relations filmeurs/filmés, soit à des conditions matérielles (paramètres de temps et d’espace, de coût, d’équipement, de climat).
Bien que la préparation soit d’une importance majeure, il faut veiller à ne pas théoriser a posteriori (et, en somme, sur-théoriser) pour justifier, consciemment ou inconsciemment, des choix qui sont souvent d’ordre pragmatique. Je terminerai par une courte réflexion prospective, en raison des changements qui sont intervenus ces vingt dernières années.
10h45 : Pause
11h : Recréer à partir d’archives de la recherche : textes, images et sons
Damien Mottier, Maitre de conférences, chaire d'anthropologie visuelle du religieux, EPHE- IMAF.
Je reviendrai sur les circonstances qui m’ont conduit à découvrir les archives d’une recherche de terrain que l’anthropologue et cinéaste belge Luc de Heusch a menée en 1953-1954 au Sankuru, en RDC, puis à recréer son premier court métrage et à monter certains de ses rushes. Après avoir exposé les matériaux sur lesquels je me suis appuyé, je présenterai les choix éthiques et esthétiques qui ont guidé ce travail de recréation. Je discuterai ensuite le sens à accorder à cette reprise d'archives, tant du point de l’histoire du film ethnographique que de celui des usages qui peuvent être faits de ces images et de ces sons, aujourd’hui, en dialogue avec les descendants et les représentants des personnes filmées.
11h45 : Table ronde avec Robert Nardone, Jean-Paul Colleyn et Damien Mottier, animée par Anne Jarrigeon, Anthropologue – vidéaste Maîtresse de conférences à l'Université Gustave Eiffel (Ecole d'urbanisme de Paris) Laboratoire Ville Mobilité Transport (LVMT)
12h15 : Pause déjeuner
14h : L’essai audiovisuel et l’approche paramétrique : le choix de contraintes pour construire de nouvelles manières de voir et d'entendre
Ariane Hudelet, Professeure de culture visuelle, cinéma, télévision. UMR 8225 LARCA, UFR, Etudes anglophones
Cette présentation défendra l’utilité d’utiliser des contraintes externes, parfois aléatoires, pour la réalisation d’essais vidéo dans le champ des études cinématographiques et audiovisuelles. L’exemple privilégié sera la série Succession (HBO, 2018-2023), plus particulièrement sa musique originale.
14h45 : Tentatives filmiques pour l’acheminement d’une pensée de milieux
Lucinda Groueff, Enseignante-chercheure, Larep, LVMT
Des formes filmiques mobilisées depuis une quinzaine d’année dans la recherche urbaine, comme en science sociale, tentent de renouveler les pratiques d’enquête, d’écriture et de médiation scientifiques. La considération des territoires comme milieux évolutifs et interactionnels engage à questionner les dispositifs de visualisation urbaine et certaines des représentations spatialisées. La fabrique des images et imaginaires territoriaux devient un des préalables à questionner, sur le terrain et pour la chercheure ou le chercheur. Le dispositif filmique, aux dimensions de saisissement spatiales et temporelles, invite à une réflexion processuelle des milieux. Un tel instrument de recherche, par les manipulations et exposition de tournage comme dans les choix de post-production, pose des conditions réflexives particulières et efficaces dans la visée d’un bouleversement des représentations. Envisager ainsi l’écriture filmique comme expérience contextuelle d’une pensée scientifique exige la souplesse méthodologique d’un processus de recherche en devenir. Un projet de recherche-création, aux productions filmiques issues de la combinaison poétique d’une multiplicité de point de vue, appuiera cette présentation. Nous nous interrogerons sur les enjeux et capacités d’une telle démarche dans l’émergence d’images et de réflexion inattendues.
15h45 : Filmer avec la parole
Michel Tabet, Chargé de recherche CNRS, Enseignant Chercheur, Laboratoire d'Anthropologie Sociale
Depuis le déclenchement de l’effondrement social, économique et politique du Liban en 2019, j’ai développé une ethnographie sonore et visuelle qui se focalise sur l’expérience et le vécu de personnes qui subissent des crises et des désastres. Devant la multiplicité, l’amplitude et l’intensité de ces événements, j’ai élaboré des approches qui mettent la parole au cœur de mon travail, postulant qu’elle représente ce qu’il reste aux humains pour habiter et raconter le monde quand les formes, les récits et les structures habituelles de l’existence volent en éclats.
M’appuyant sur quelques exemples extraits de ces travaux, j’expliciterai l’esthétique et l’épistémologie des dispositifs que j’ai employés, en mettant l’accent sur les conditions d’enregistrement et de montage de réalités qui saturent les capacités de l’enquête et de la représentation ethnographiques : la crise économique, l’explosion du port de Beyrouth, la guerre de 2024. Le fil directeur de cette intervention tourne autour du principe de polyphonie que j’ai adopté pour mettre en lumière les processus de fragmentation et d’éclatement des subjectivités en temps de crise : comment écouter ? Comment entendre ? Comment comprendre et faire entendre des voix prises dans le vacarme des catastrophes ? Comment articuler, juxtaposer et faire résonner des sons et des images provenant d’une multiplicité de sources différentes ? Ce principe d’enquête polyphonique renvoie, par-delà la volonté d’appréhender et de restituer une pluralité et une multiplicité d’expériences, à l’impossibilité d’épuiser le réel ou de privilégier certaines voix plutôt que d’autres.
16h30 : Table ronde avec tous les intervenants, animée par Nathalie Luca, Directrice de recherche au CNRS et présidente du Comité du film ethnographique
Le conseil scientifique
Robert Nardone, HT2S-Cnam (Historien des sciences et des techniques)
Loïc Petitgirard, HT2S-Cnam (Professeur en histoire des sciences et des techniques, directeur du laboratoire HT2S)
Catherine Radtka, HT2S-Cnam (Chaire junior Mutation de l’aéronautique et du spatial) Jean-Claude Ruano-Borbalan, HT2S-Cnam (Professeur, Chaire techniques et sciences en société)
Le comité d’organisation
Gloria Fernandez-Garcia, PhD (Secrétariat des Laboratoires DICEN-IdF et HT2S)
Robert Nardone, HT2S-Cnam
Lien pour la connexion à distance
Lien pour s'inscrire